• Siège administratif : 222, avenue de Versailles 75016 Paris • 01 42 65 08 87 • dlf.paris@club-internet.fr •
La langue française pour Claude Imbert

Après son allocution , notre président laissa la parole à Claude Imbert.
Le lauréat du prix Richelieu 2008 prononça aussitôt son discours de
Jean Dutourd lui remit ensuite notre traditionnelle médaille à l’effigie d’Orphée, ainsi que le Dictionnaire culturel en langue française, d’Alain Rey, offert par les éditions Le Robert.
Je me sens honoré, mais, en même temps, devant vous interdit. Pourquoi ? Parce que je voue à la langue française une affection si intime que je ressens quelque impudeur à la confesser. Nous sommes tous fils de notre langue, Français par elle, humanisés, socialisés par elle. Mais certains – dont je suis – éprouvent vivement cette appartenance. Parce qu’elle m’a ouvert un monde où je n’étais pas né, donné une profession que j’aime et des bonheurs constants. D’où reconnaissance, affection et, au fil du temps, une passion toujours incandescente. Bref, voici l’aveu, je suis un amoureux transi de la langue française.
Dans la petite ferme aveyronnaise où je suis né, il y a bien longtemps, on parlait le provençal. Un grand-père instituteur distribuait, dans les cours de récréation, de petites taloches aux galopins qui baragouinaient encore le patois. Mon coup de foudre vient de là et vient de loin. Dans une bicoque médiévale de Sévérac-le-Château, un grand-oncle cheminot qui m’hébergeait était aveugle. Deux heures par jour, entre mes sept et neuf ans, je lui lisais les titres du journal local. Et la petite dizaine de romans – Alexandre Dumas, Anatole France, le Victor Hugo des Misérables – qui constituaient son unique trésor. Ponctué, à chaque page, par une visite ingrate au Petit Larousse, un sentier lumineux m’ouvrait un monde inconnu, éblouissant d’océans et d’aventures, de châteaux et d’intrigues, de périls et de fêtes bien inaccessibles à mon petit terrier campagnard. Dans ce passé sans télévision, la magie de la langue me découvrit un univers mirobolant.
Propulsé ensuite par ce qu’on appelait le mérite républicain, grâce à la langue et aux humanités classiques qui existaient encore, j’appris le monde par les livres. Avec Montaigne les prémices d’un art de vivre, avec Balzac et Stendhal les mystères de la comédie humaine, les sacs et ressacs de la religion, de l’argent, de l’amour, des passions. Le monde quoi !
Le journalisme où j’entrai à 20 ans me fit passer de la lecture à l’écriture. Tout au long d’une longue vie, la langue devint ma plus proche compagne.
Indocile quand elle impose l’ascèse de la clarté et qu’il faut dire en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. / Dangereuse séductrice quand elle flatte l’imagination, la folle du logis. / Sorcière quand elle se sert de nous quand nous croyons nous servir d’elle. / Consolante quand, dans les tourments de l’actualité, les seuls bonheurs deviennent des bonheurs d’expression. / Une muse intermittente, enfin, quand la couleur, la sonorité d’un mot ennoblit la trame désolante de ce qu’on appelle « la communication »...
Je vois la langue comme une personne : juvénile au XVIe, foisonnante, savoureuse, débridée. Puis tout juste adulte au XVIIe, sûre d’elle-même, taillée en jardins à la française, propre à l’apparat et à la maxime. Au XVIIIe, rapide, pointue, rhétorique, encore ardente mais déjà efflanquée, cassante. Au XIXe, fardée, alanguie, avec de sombres éclats étrangers à son génie quand lui tombe dessus la dépression nerveuse du romantisme.
Ma révérence pour la langue française me fait conservateur pour ménager la saveur des accents, la belle démarche de la ponctuation. Je déplore l’oubli des points-virgules et l’extinction du subjonctif. J’abhorre le jargon des récents pédagogues, calamiteux Diafoirus à qui ne manque qu’un Molière. Mais j’ouvre volontiers portes et fenêtres aux Français venus d’ailleurs, du Québec, des Caraïbes, d’Afrique noire comme au parler des terroirs de France. Une averse qui me tombe dessus, c’est, pour moi, la drache des Belges ; le fouillis d’un placard, c’est le chenis des Vaudois. Je crains, en prolongeant ma parlote, de vous ensuquer à la marseillaise. Restons zen, ou, comme on dit, dans le 9-3, restons moelleux...
Bref, ne désespérons pas de la langue française ! Il lui faut des défenseurs, des militants. Mais sans intégrisme ! À l’orée du siècle passé, 10 % de nos compatriotes ne la lisaient ni ne l’écrivaient. Avec 200 millions de francophones, elle a de quoi se ressourcer, se revivifier... Les paladins que vous êtes de la langue française ne vivent pas dans une citadelle assiégée. Comme la vie, comme la mer, la langue française est toujours recommencée !
SES ŒUVRES :
 Ce que je crois (1984) |
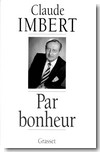 Par bonheur (1994), prix de l’essai de l’Académie française (1995) ; À point nommé (1997) |
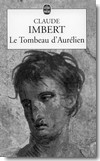 Le Tombeau d’Aurélien (2000), prix de la Baie-des-Anges-Ville de Nice 2000 . |
• Siège administratif : 222, avenue de Versailles 75016 Paris •